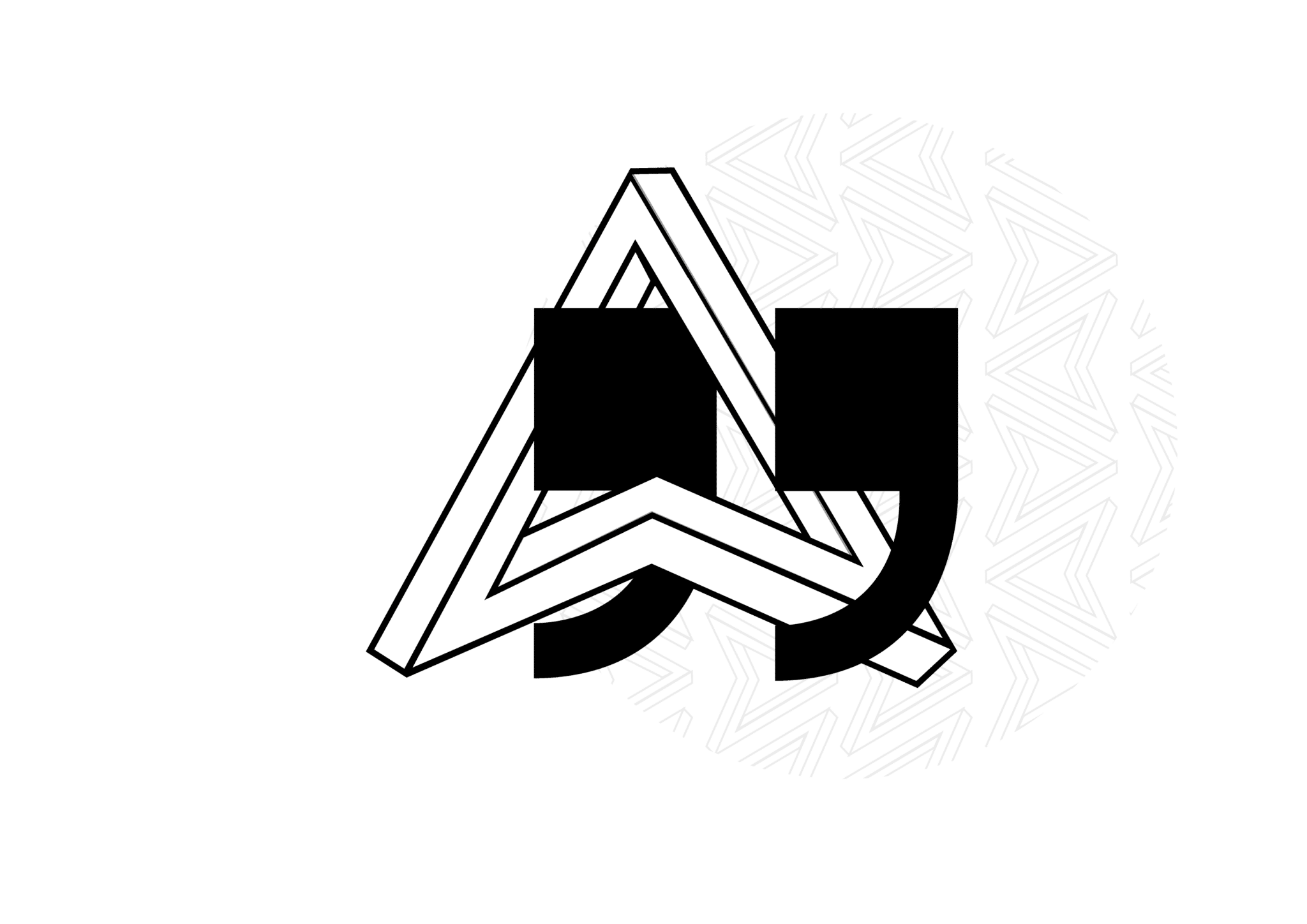
Il était midi, ce lundi 7 avril, quand une avalanche a balayé la paroi de l’Annapurna, tuant deux sherpas népalais. Rima Rinje et Ngima Tashi se trouvaient au-dessus du camp 2, vers 5600 mètres. Ils étaient chargés de ravitailler les camps en bouteilles d’oxygène, quand une énorme avalanche s’est déclenchée. Par miracle un troisième sherpa, Pemba Thenduk, pris lui aussi dans l’avalanche, a réussi à s’en sortir. Les trois hommes travaillaient pour l’agence Seven Summit Treks.
L’un de ses dirigeants, et leader de l’expédition à l’Annapurna, Chhang Dawa, a annoncé la catastrophe et immédiatement envoyé un hélicoptère, et une équipe de quatre autres sherpas pour tenter de retrouver Rima et Ngima, sans succès.
Quelques heures plus tôt, près de quarante personnes ont atteint le sommet du géant himalayen. Parmi eux, une grosse moitié de sherpas, qui aident les clients « huitmillistes » à réussir leur objectif. Le rituel des expés commerciales est rodé : une équipe de pointe – des sherpas – atteint le sommet, ouvrant la voie et équipant celle-ci de cordes fixes, puis une deuxième vague de sherpas emmène les clients au sommet. Pendant ce temps, les petites mains ravitaillent les camps en nourriture, et en précieuses bouteilles d’oxygène, sans lesquelles les clients ne reviendraient pas de « leur » sommet.

L’Annapurna cette année. La voie normale passe dessous et entre les séracs au centre. ©Csaba Varga
Le prix à payer ? Il est très élevé. À l’Everest, le 18 avril 2014, l’une des avalanches les plus meurtrières de l’histoire himalayenne a provoqué la mort de seize hommes dans l’ice-fall, dont trois ne seront jamais retrouvés. Tous des sherpas chargés de l’équipement et du ravitaillement de la voie normale.
Le 7 avril 2025, même scénario à l’Annapurna. Fatalité ? Pas vraiment. À l’Everest, les agences – népalaises comme occidentales – ont compris que moins leurs clients passaient du temps dans l’ice-fall, mieux c’était. Pendant que les sherpas s’échinent à transporter des charges dans un glacier chaotique, surplombé par des séracs menaçants, les clients s’acclimatent au Lobuche ou à l’Island Peak. Et ne font que deux, voire une seule rotation à travers l’ice-fall. Le même raisonnement s’applique pour l’Annapurna.
Le « premier 8000 » est plus que jamais méconnaissable : la sécheresse et le changement climatique ont transformé sa voie normale, sise versant nord, en un parcours épouvantable entre tranches de séracs, crevasses et glace noire. Si ce sommet ne faisait pas partie des 8000, personne n’aurait l’idée funeste d’y grimper. Que dirait-on si des guides français étaient obligés de travailler dans pareil endroit ?
Peu avant le drame de lundi, Mingma G. Sherpa, dirigeant d’agence et leader d’expédition, annonçait que c’était sa dernière à l’Annapurna, sa plus difficile saison en raisons des conditions : « je ne veux plus risquer ma vie ici ».
« je ne veux plus risquer ma vie à l’Annapurna » Mingma G.
Seulement voilà. D’autres sherpas vont continuer le job, faute d’en avoir un autre. Ils trimballent le matériel, font la trace, fixent des milliers de mètres de cordes fixes. Comme l’explique Bernadette McDonald dans son nouveau livre indispensable, les vrais héros de l’Himalaya, ce sont eux.
Des sherpas qui étaient indemnisés « dix roupies le doigt » (gelé puis amputé) dans les années 30. Combien aujourd’hui pour les deux familles endeuillées ? Sans doute plus, heureusement, grâce aux propriétaires népalais de l’agence qui les emploient. Sans doute jamais assez, quoi qu’il en soit. Surtout pour satisfaire l’ego de la clientèle mondialisée qui glane les quatorze 8000 sans connaître le nom de ceux qui se sacrifient.

