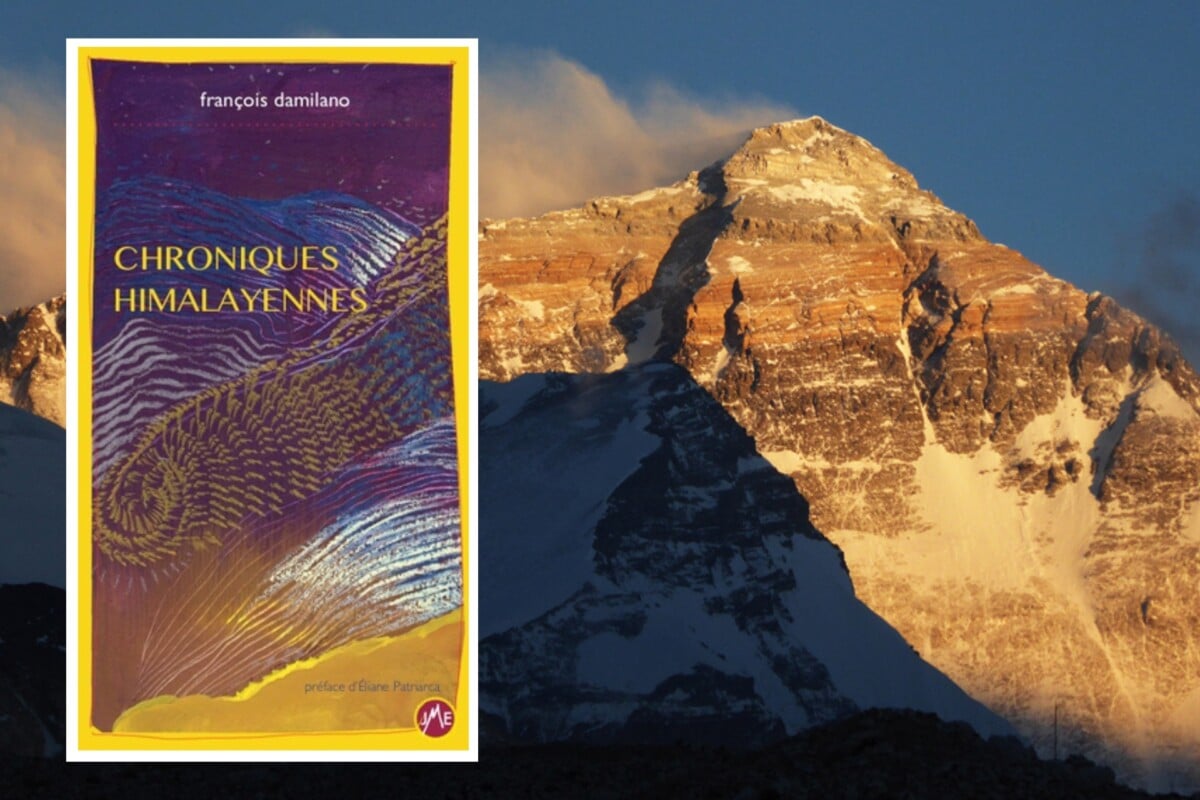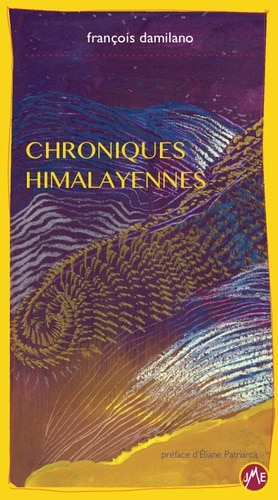Il a pris l’habitude d’écrire et même de filmer, en plus de gravir : François Damilano n’a de cesse de raconter l’Himalaya qu’il parcourt depuis des années. Chroniques himalayennes, petit recueil de ses diverses chroniques, vient de paraitre. Il nous en offre un extrait intitulé Regard d’Everest, dans lequel il tente répondre aux questions que cette montagne symbolique, qu’il a gravie en 2014, pose plus que jamais. Extrait.
Chamonix, 2014
La représentation de l’alpinisme dépasse le simple champ sportif. Celle de l’Everest porte bien au-delà des himalayistes. En clair, le rêve d’Everest ne prend pas forme uniquement dans la tête des alpinistes. Sa conquête même est jalonnée de tentatives aussi audacieuses qu’originales émanant parfois d’hommes qui n’avaient aucune expérience de l’art de gravir les montagnes. Mais compte tenu de l’éloignement, des difficultés d’organisation et d’approche, l’himalayisme de conquête a été presque exclusivement réservé à des équipes aguerries soutenues par leurs nations.
L’apparition des expéditions guidées marque un tournant décisif dans la sociologie des huitmillistes. En 1980, le Suisse Max Eiselin propose ouvertement des places contre rémunération dans son expédition au Dhaulagiri (8 167 m). Dans son sillage, d’autres guides proposent organisation puis encadrement de sommets phares comme le Cho Oyu (8 201 m) et surtout l’Everest (8 848 m) en synergie avec des agences népalaises spécialisées dans l’organisation de trekkings et alors en plein essor. Dès lors, il n’est plus nécessaire de faire partie du sérail de l’alpinisme pour prétendre gravir l’une des plus hautes montagnes du monde. « Le capital symbolique devient accessible au capital tout court ».
Peu à peu, des guides se spécialisent dans cet accompagnement en très haute altitude permettant à des amateurs — au sens noble du terme — d’atteindre les plus hautes cimes. Le nombre d’ascensions des plus hauts sommets se multiplie et l’apparition de cette nouvelle population dans le cercle restreint des himalayistes complexifie les images et brouille les discours établis. Médias et sponsors démêlent difficilement ce qui relève de la performance d’avant-garde, de l’expérience extra-ordinaire individuelle. Collectionnant les quatorze sommets de plus de 8 000 mètres, certains performers participent eux-mêmes à maintenir la confusion. En un glissement étonnant, les ascensions des sommets de plus de 8 000 par leur voie classique prennent un goût de frelaté et sont regardées avec condescendance par une partie du milieu de l’alpinisme. Une sorte de débat en légitimité de ces néo-huitmillistes ne cessera de grandir pour atteindre son apogée en 1996 avec la mort de deux guides et plusieurs clients lors de la descente du sommet de l’Everest.
La dénonciation de la marchandisation des hautes montagnes s’affirme avec une remise en cause d’une industrialisation des services et de la dénaturation de l’esprit d’aventure. L’image véhiculée par l’Everest se réduisant alors le plus souvent aux excès et dérives inhérents à une fréquentation subitement accrue et à une explosion d’une sociologie jusque-là bien établie.
Aujourd’hui, la majorité des expéditions présentes sur l’Everest sont organisées par des guides occidentaux ou des agences népalaises pour une somme variant entre 60 000 et 200 000 € par personne en 2023, dont 10 000 € pour la seule autorisation. Un investissement financier qui se double d’un investissement en temps : acclimatation et caprices de la météo obligent, deux mois sont nécessaires pour espérer taquiner ce sommet de presque 9 000 m.
En progression régulière depuis le début des années quatre-vingt-dix, le nombre de summiters augmente de manière significative à l’orée de la décennie 2000. Du 22 au 25 mai 2001 par exemple, il y a eu plus de monde au sommet (187) que durant les trente années qui ont suivi la première ascension de Tenzing et Hillary en 1953. Le record de 32 summiters un même jour établi le 12 mai 1992 est pulvérisé dix ans plus tard avec 70 personnes le 16 mai 2002, puis 223 personnes pour la seule journée du 22 mai 2019. Actuellement, environ 500 personnes parviennent chaque (bonne) année à gravir le Toit du monde.
Après les balbutiements des premiers guides, quelques opérateurs ont en effet développé un savoir-faire inédit par leur spécialisation et leur implantation sur les pentes de la montagne. Leur présence répétée chaque saison permettant d’optimiser un investissement conséquent (assurant davantage de confort dans les camps par exemple) et de planifier les stratégies d’ascension et d’accompagnement. (…)
Certains himalayistes dénonçent
la commercialisation et la dérive
de l’esprit de l’alpinisme
Cette reconduction systématique et saisonnière par les mêmes organisateurs suscite le débat de la marchandisation des sommets emblématiques. Certains himalayistes dénonçant la commercialisation et la dérive de l’esprit de l’alpinisme, stigmatisant la dénaturation du métier de guide par une préemption de fait de la montagne par des agences au profit de la massification d’une clientèle avide de trophées. Au schéma classique du petit groupe de clients fidèles et de son guide-artisan partant à l’aventure sur un terrain sans cesse renouvelé, semble s’opposer la logique de l’agence structurée autour d’une organisation rodée ouvrant ses portes à des aventuriers-consommateurs aux détriments des alpinistes-de-culture. « Les véritables montagnards ont une démarche progressive, sans porteur, sans oxygène et sans camp fixe. Or il y a désormais un phénomène sommet. On se paie un sommet sans avoir fait de montagne auparavant, c’est devenu une activité de troupeau affirme » par exemple Christian Trommsdorff, président du Groupe de Haute Montagne. Et l’himalayiste de pointe de dénoncer l’apparition d’un tourisme d’altitude en posant la question de la manière de gravir les plus hautes montagnes : « chaque démarche est respectable, mais chacun doit avoir conscience des moyens qu’il a utilisés (oxygène, cordes fixes, aide au portage, assistance des sherpas)… Le débat porte sur la question de savoir quel est le plus important : le résultat — j’ai fait l’Everest — ou les émotions et les expériences vécues liées aux moyens utilisés. »
tous ont
un même
désir d’Everest
Explicitement est ainsi posée la question du profil des prétendants aux hautes montagnes, question qui interroge la nature même de l’alpinisme et les moteurs du métier de guide. Qui est alpiniste ? Les montagnes sont-elles réservées aux alpinistes ? L’écrivain Jean-Michel Asselin apporte un regard débarrassé d’un idéalisme de bon ton : « À l’Everest, il y a des gens dont on ne peut pas contester la légitimité — des professionnels, des alpinistes très expérimentés — et puis il y a des gens qui ne sont pas des alpinistes géniaux ou qui ont très peu d’expérience. Pourtant tous ont un même désir d’Everest. Et chacun a organisé son désir, chacun a organisé la possibilité d’accéder à son désir… Pourquoi certains seraient plus légitimes que d’autres ? Quel diktat un peu obsessionnel d’une communauté d’alpinistes dirait toi tu as le droit, toi tu n’as pas le droit, toi tu le mérites, toi non »
je me planque derrière
ma caméra
je m’efforçe d’abandonner
mes partis pris
Et moi, dans tout cela ? Sur mon chemin de l’Everest, je me planque derrière ma caméra et je m’efforçe d’abandonner mes partis pris, de me débarrasser de mes biais. Partagé entre mon goût de la performance, mon réalisme de guide et mon expérience d’himalayiste, je m’interroge souvent sur la valeur de mon ascension au sein de l’équipe d’encadrement de Kari Kobler.
Mais pousser ma poignée autobloquante sur la corde fixe, découvrir l’usage de l’oxygène artificiel, trouver les tentes montées aux camps d’altitude, rassurer mon binôme sherpa lorsqu’il s’effraie de me voir m’affranchir de la ligne de vie pour voler quelques plans… n’a pas entamé l’immense bonheur de vivre une fois dans ma vie une expédition sur la plus haute montagne du monde.