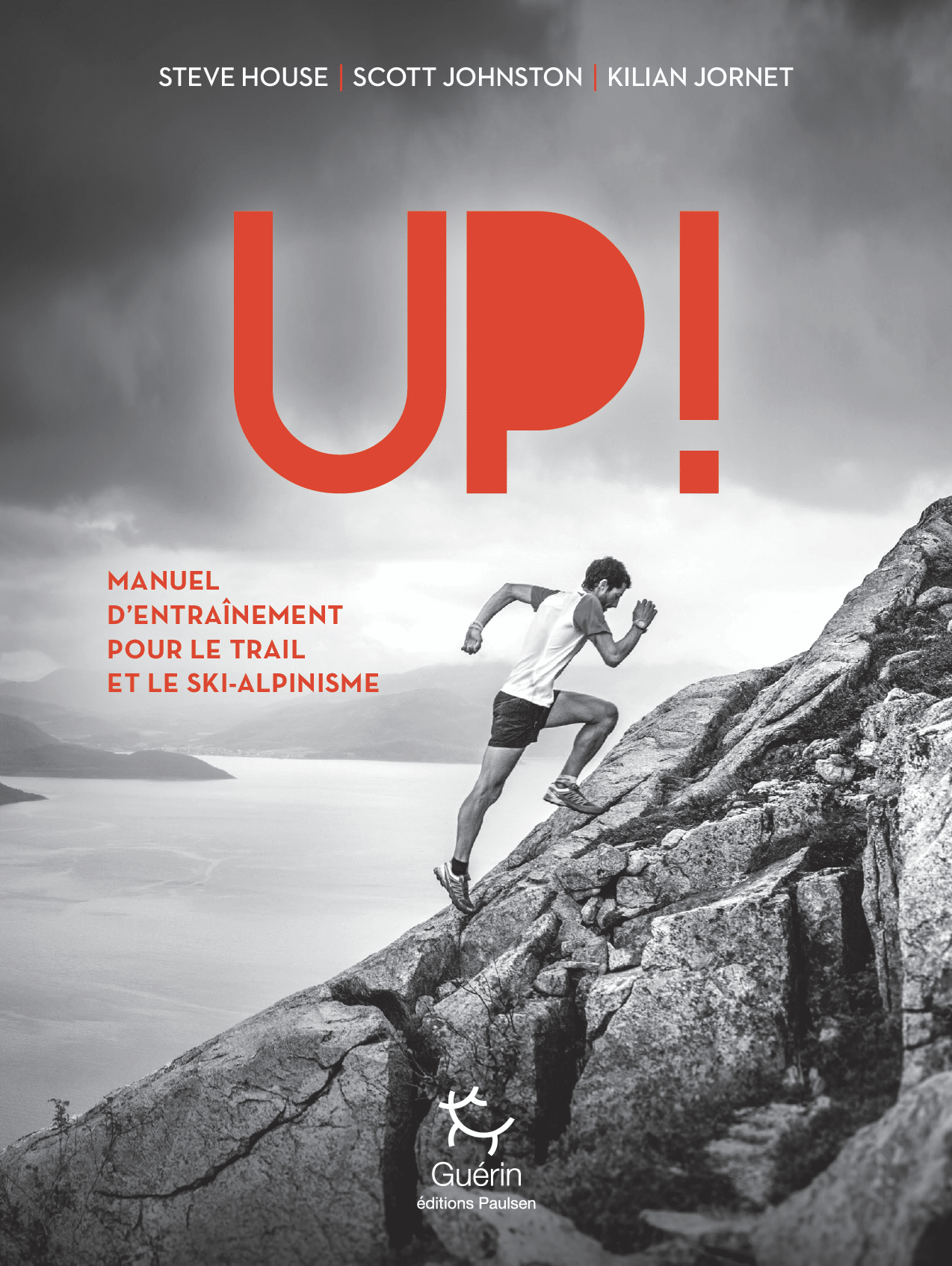Avec Up ! Steve House, Scott Johnston et Kilian Jornet ont mis en commun leurs dizaines d’années d’expérience en matière d’entraînement. Qu’il s’agisse de trail running en montagne ou de ski-alpinisme, ce manuel d’entraînement, édité par l’équipe d’Alpine Mag pour les Editions Guérin-Paulsen, livre le fruit du travail de ces athlètes et entraîneur hors du commun, comme nous l’a confié Kilian Jornet lui-même. Extraits.
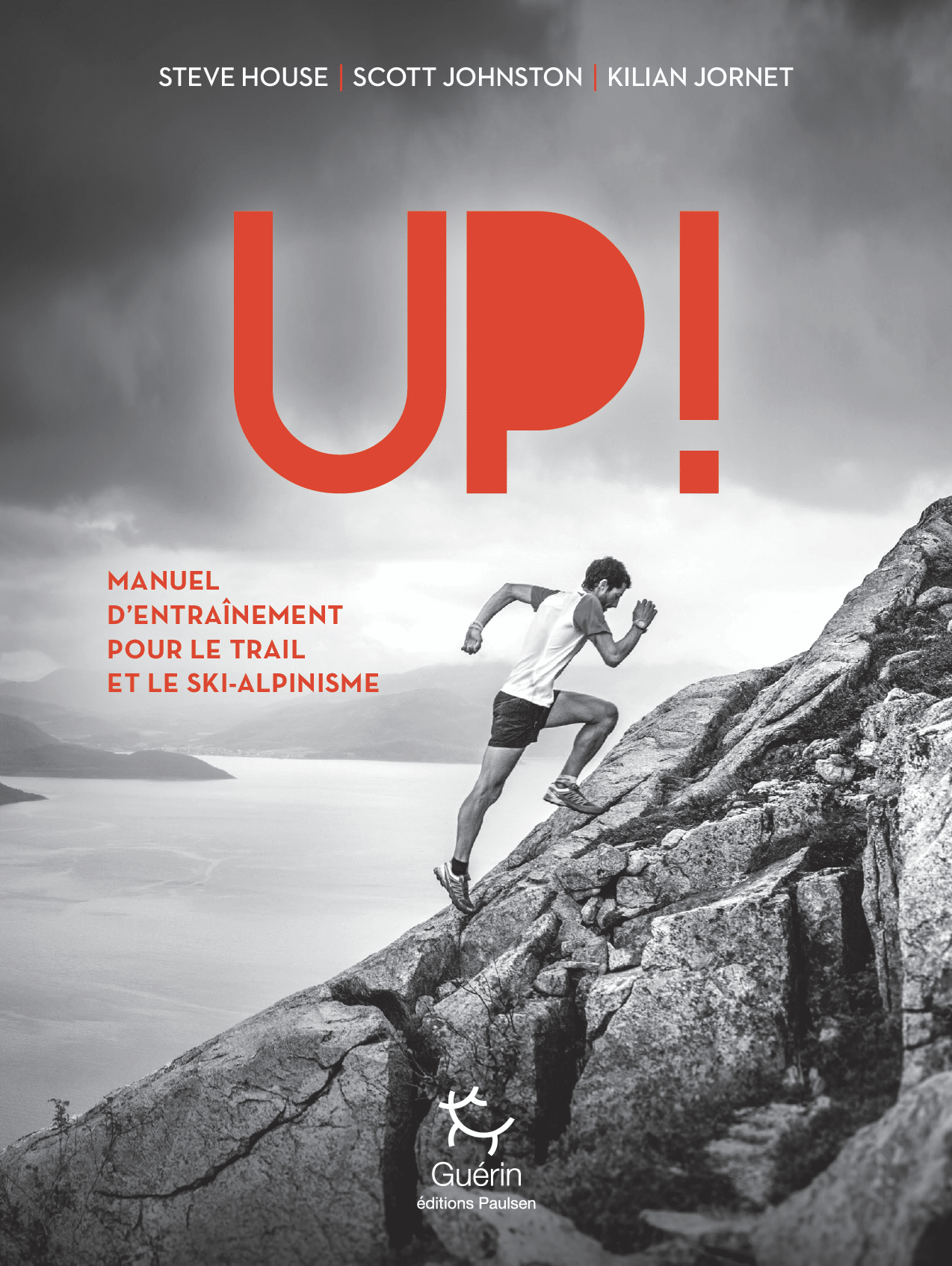
Up ! Guérin-Paulsen, 375p., 2020. Extrait du chapitre 2 – La physiologie des sports d’endurance.
Ne lisez pas ces pages importantes trop rapidement, dans votre hâte de découvrir les séances d’entraînement qui vous permettront de battre Kilian lors de sa prochaine course. Vous ne les trouverez pas. Comme nous le répétons plusieurs fois dans ce livre : il n’existe pas de recette unique pour maximiser la forme physique. Vous êtes le seul à pouvoir optimiser votre programme idéal. Nous vous proposons ces premiers chapitres précisément en raison de la nature individuel de l’entraînement. Nous savons que vous avez besoin de ces informations pour prendre de bonnes décisions concernant vos programmes d’entraînement.
Dans ce chapitre, nous examinerons la physiologie qui permet la production de l’énergie nécessaire aux activités d’endurance. Les connaissances de base sur le fonctionnement de cette physiologie seront le cadre intellectuel qui vous permettra de prendre des décisions lorsque vous préparerez et mettrez en œuvre votre propre entraînement ou celui d’autres personnes. Suivre aveuglément n’importe quel programme sans comprendre les principes sous-jacents handicapera, voire minera, votre performance. Les considérations à venir traitent de la physiologie de l’effort.
L’évolution de l’endurance
Pendant des milliers d’années, plusieurs espèces du genre Homo évoluaient en parallèle, coexistaient et rivalisaient avec l’Homo sapiens en tant que chasseurs-cueilleurs. Le fait que nous ayons gagné le concours de l’évolution est dû en partie à la capacité d’endurance de notre espèce. La rareté était l’état normal des choses et la compétition pour obtenir des calories exigeait beaucoup de temps et d’énergie ; par conséquent le métabolisme de l’homme préhistorique a évolué pour donner à ceux qui utilisaient les précieuses calories de la façon la plus économique la meilleure chance de transmettre leurs gènes à la génération suivante.
Les journées habituelles étaient faites de longues heures de recherche de nourriture à moindre effort, ponctuées de courts moments d’efforts intenses pendant le temps fort de la chasse ou lorsqu’il était nécessaire de maîtriser une proie ciblée ou de surpasser un autre prédateur ou charognard. La composition de l’alimentation des premiers hominidés était riche en graisses et en protéines animales, avec une petite quantité de glucides complexes d’origine végétale. La physiologie de l’homme préhistorique a développé un réservoir de carburant calorique sous forme de réserves de graisse (à la fois intramusculaire et sous-cutanée, les lipides) pour stocker l’excès de calories consommées pendant les périodes d’abondance. Les matières grasses pouvaient nourrir nos ancêtres pendant ces longues journées de chasse et de cueillette et leur donner une plus grande chance de survie en période de pénurie alimentaire. Nous avons évolué pour stocker la graisse en grandes quantités afin de survivre pendant de nombreux jours de famine avant que notre corps n’encoure de dommages permanents. Le chasseur-cueilleur bien adapté pouvait laisser passer plus de temps entre les repas et avoir une activité intense grâce aux lipides, économisant ainsi les réserves rares et précieuses de glycogène qui provenaient des glucides. Notre capacité à récupérer rapidement nos réserves de glycogène musculaire pendant les périodes de repos (en quelques heures seulement) constitue un autre aspect intéressant de ce sujet. Ce n’est pas le cas pour la plupart des autres espèces animales ; ainsi, nous pouvions épuiser nos proies puisque nous n’avions besoin que d’une courte période de récupération.
Le chasseur-cueilleur pouvait laisser passer plus de temps entre les repas et avoir une activité intense grâce aux lipides, économisant ainsi les réserves de glycogène qui provenaient des glucides. Notre capacité à récupérer rapidement nos réserves de glycogène musculaire pendant le repos constitue un autre aTOUT.
Un lipide est une molécule complexe avec de nombreuses liaisons chimiques, chaque liaison contenant de l’énergie qui peut être utilisée. Même un sportif d’endurance svelte et bien entraîné peut transporter jusqu’à 100 000 calories stockées sous forme de lipides facilement accessibles. Les glucides, qui sont des molécules plus simples avec moins de liaisons chimiques, produisent environ moitié moins de calories par gramme que les lipides. Nous avons une capacité de stockage de glucides beaucoup plus petite, qui ne dépasse pas 2 000 calories, même chez un athlète bien entraîné. Pendant les périodes d’excès, la stratégie de notre corps est de stocker toutes les calories que nous consommons, quelle qu’en soit l’origine, sous forme de lipides. D’un point de vue purement physiologique, cela explique l’épidémie d’obésité des temps modernes ; de nombreux humains consomment une abondance d’aliments riches en calories et sont rarement exposés à des pénuries alimentaires.
Selon une théorie populaire en biologie évolutive, les premiers hominidés profitaient de leur endurance et de leur faible pilosité (qui leur permettait d’éviter la surchauffe dont pouvait souffrir leur proie) pour pourchasser jusqu’à épuisement l’animal qui constituerait leur prochain repas. Cela les a aidés à se hisser au sommet de la chaîne alimentaire malgré leur relative faiblesse physique. C’est grâce à leur endurance que nos ancêtres ont pu approcher et tuer des animaux beaucoup plus puissants qu’eux, trop fatigués pour se défendre. La théorie dit aussi que le régime riche en protéines, grâce au succès de la chasse, a permis d’augmenter la capacité et la complexité du cerveau. Cela a produit une révolution cognitive, qui a à son tour engendré les avancées culturelles et l’évolution des caractéristiques dont nous avons hérité par la suite. Il s’ensuit que vous pouvez lire les mots sur cette page précisément parce que notre espèce a survécu en utilisant sa capacité inhérente à supporter une longue durée de travail d’intensité faible à moyenne. Nous sommes le fruit d’un processus évolutif qui nous prédispose à l’endurance.

Kilian Jornet à l’entraînement à Romsdal, en Norvège, deux semaines avant de partir pour l’Everest en mars 2017. ©Jordi Saragossa
Endurance et fatigue
L’entraînement en endurance vise à améliorer notre capacité à courir, à grimper ou à skier pendant une période prolongée. L’endurance est finalement limitée par la réaction prévisible de notre corps à la fatigue due à ces activités. C’est la fatigue qui limite l’endurance. Pour cette raison, une brève description de cet état s’impose. En athlétisme, l’endurance est le rythme maximum durable (en termes de vitesse ou de puissance par exemple) qu’un athlète peut maintenir pendant toute la durée d’une épreuve avant que la fatigue n’impose une réduction de ce rythme. La fatigue dans nos sports se manifeste par une longueur de foulée réduite et un rythme de foulées plus lent. Plusieurs systèmes physiologiques interconnectés influencent ensemble la performance en endurance lors d’événements de durées et d’intensités différentes. Par exemple, un kilomètre vertical se déroule à une intensité très différente de celle d’une course de 50 kilomètres. Cependant, les deux épreuves testeront la limite de l’endurance / la fatigue spécifique du coureur. Le type d’endurance nécessaire et le type de fatigue ressentie varient selon le type d’épreuve.
Nous n’avons pas besoin d’un chercheur spécialiste en physiologie de l’effort pour nous dire que la fatigue nous ralentit. Un entraînement approprié nous rend plus résistants à la fatigue et prévient ainsi le ralentissement. Nous sommes des organismes très complexes et de multiples adaptations à plusieurs systèmes corporels sont nécessaires pour améliorer notre résistance à la fatigue. Pour simplifier : ce ralentissement redouté que nous détestons tous est causé principalement par l’incapacité de notre corps à satisfaire les besoins énergétiques liés à l’effort. Cette limitation est causée par une diminution ou une accumulation de certains métabolites, ou encore une réduction du message nerveux moteur.
En substance, nous pouvons regrouper ces différents systèmes physiologiques comme vous le lirez ci-dessous. Nous créons un modèle, une délimitation artificielle et une ségrégation de ces systèmes qui sont, en réalité, intimement interconnectés et interdépendants. Cette approche du modèle simplifié est couramment utilisée en science pour décomposer des systèmes et des idées complexes en leurs éléments constitutifs, qui peuvent alors être mieux compris. L’art de l’entraînement s’appuie, en partie, sur une compréhension de l’interconnectivité et de l’interdépendance de ces systèmes.
Le système d’apport en oxygène
Le cœur, les poumons et les vaisseaux sanguins constituent le système d’oxygénation responsable de l’apport d’oxygène (O2) à toutes les cellules du corps, y compris celles des muscles squelettiques, pendant l’effort.
Poumons. Bien que nous ayons l’impression d’être « essoufflés » pendant un exercice intense, les poumons sains sont en fait surdimensionnés pour nos besoins et ont une capacité d’échange gazeux largement suffisante. Les poumons humains ont une surface équivalente à la surface d’un demi-court de tennis.
Cœur. De nombreuses études scientifiques ont montré que la plus ou moins grande capacité du cœur à pomper peut être le principal obstacle à l’apport en O2 chez les personnes en bonne santé. Cependant, alors que les poumons n’évoluent plus après la puberté, le cœur peut être entraîné pour augmenter son débit par minute, ce qui signifie une augmentation d’O2 distribué aux muscles. Cette adaptabilité est contrainte par notre génétique et par nos antécédents d’entraînement en endurance. Le cœur atteint sa pleine maturité à l’adolescence, évoluant le plus rapidement et le plus fortement pendant cette période. Les jeunes, comme les personnes plus âgées et non entraînées, peuvent constater des changements rapides et significatifs des battements de leur cœur parce que le muscle cardiaque est très facile à en- traîner, dans la limite de ce qui est prédéterminé génétiquement. Cette limitation du volume systolique définit la limite supérieure absolue de l’apport en O2 et devient donc une limite à la puissance aérobie. Pour les athlètes matures (ayant un long passé d’entraînement en endurance), l’entraînement n’apportera que peu ou pas de changement de leur volume systolique. (…)
H I S T O I R E S D’ A T H L È T E S
Comment j’ai débuté en athlétisme / par Kilian Jornet
Autour de la maison où j’ai grandi, il y avait des montagnes et des forêts. Je n’ai vu ma première télévision qu’à l’âge de cinq ans. Lorsque ma petite sœur et moi n’étions pas à l’école, nous jouions tout le temps dehors, grimpions aux arbres et sautions des rochers. En tant qu’enfant, passer son temps à l’extérieur est une expérience unique : celle d’être en plein air, dans la forêt et dans la neige, et de s’habituer à ce genre de terrain montagneux.
Mon père et ma mère étaient tous les deux des passionnés de montagne. Mon père était guide de haute montagne avec une vision plutôt traditionnelle de l’alpinisme ; il m’a appris la technique, la sécurité et le respect de cet environnement. Ma mère était une grimpeuse et une coureuse de longue date, un peu moins organisée, mais très expérimentée. Elle était beaucoup plus libre dans les montagnes. Elle aimait progresser rapidement et en toute légèreté.
Quand j’avais trois ans, nous avons commencé à gravir des sommets en famille. Nous faisions du ski de fond et mes parents portaient nos skis alpins pour la descente. C’était mon initiation au ski-alpinisme. Lorsque j’ai atteint mes cinq ans, nous faisions des sommets à 3 000 mètres d’altitude et nous nous entraînions à progresser sur glacier, encordés, avec crampons et piolets. Pendant cette période, j’ai aussi fait mes premiers couloirs faciles. Sur les photos de l’époque, le casque sur ma tête est si grand que j’ai l’air d’un champignon.
L’année de mes dix ans, nous avons traversé les Pyrénées sac au dos, un périple de quarante jours. Nous faisions quelque chose de ce genre-là chaque année. C’est comme ça que j’ai appris l’endurance et la manière de continuer à marcher pendant plusieurs jours. Quand j’avais treize ans, ma mère a commencé à m’emmener pour de plus longues sorties en montagne, et parfois je n’apportais pas assez à manger ou à boire. Je me souviens d’avoir passé jusqu’à seize heures sans eau ni nourriture, en léchant l’eau sur les rochers.
C’est à cette époque que j’ai commencé à m’entraîner pour le ski-alpinisme. J’avais fait de longues courses cyclistes et des 80 kilomètres de refuge en refuge, sans suivre un quelconque programme d’entraînement. Je suis entré au centre de formation sportive de Catalogne, et mon entraîneur m’envoyait chaque mois un programme d’entraînement me disant ce que je devais faire chaque jour. Il y avait deux entraîneurs, et peut-être dix personnes athlètes par entraîneur. De treize à dix-sept ans, j’ai appris à connaître les notions de volume musculaire, d’entraînement en fractionnés, de force, de récupération ainsi que les conditions en montagne et la technique.
À cette période, j’allais à l’école, donc je m’entraînais tôt le matin ou après les cours, et en milieu de journée, j’allais au gymnase ou courir. J’utilisais les week-ends pour des courses plus longues. Parfois, j’allais à l’école à vélo, mes skis dans mon sac à dos, et après l’école, je pédalais 60 kilomètres jusqu’au front de neige, je skiais pendant deux heures, puis je rentrais, toujours à vélo. D’autres jours, je courais respectivement 25 kilomètres à l’aller et au retour de l’école. Très régulièrement, mon entraîneur me reprochait d’en faire trop, même si je lui expliquais que le vélo n’était que mon moyen de transport. J’étais vraiment focalisé sur l’entraînement, voire obsédé. (…)
Lire notre interview de Kilian Jornet à propos de la sortie de Up !