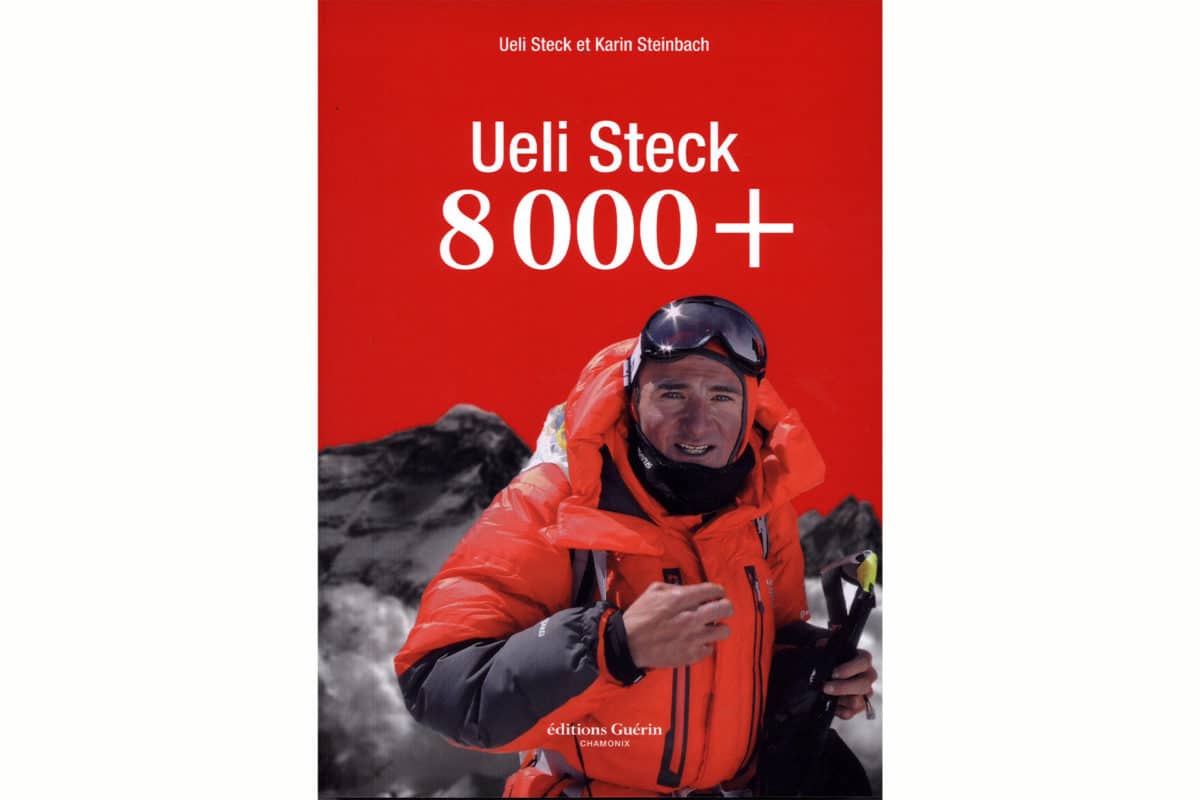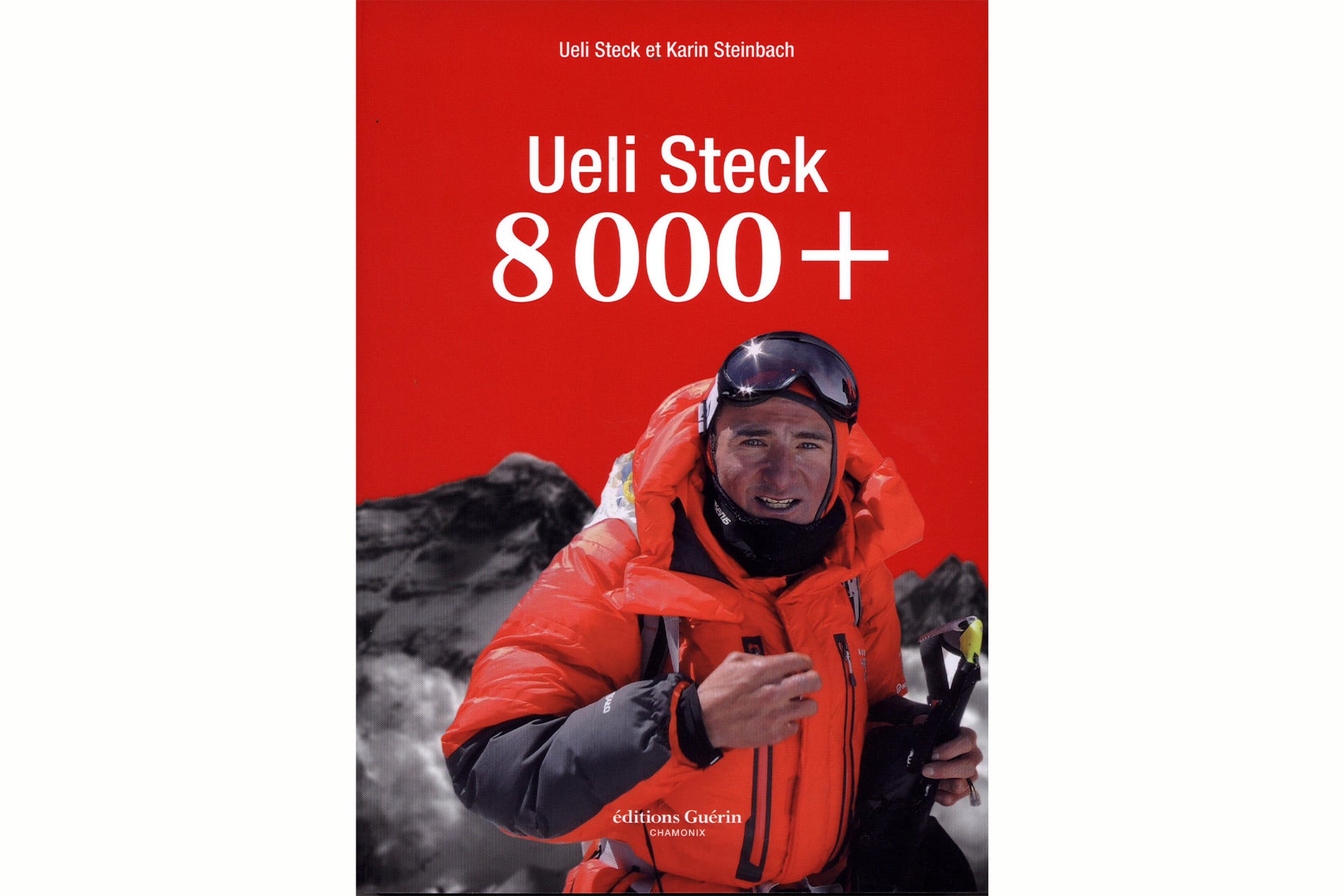Ueli Steck a disparu il y a trois ans en Himalaya. À cette occasion, nous publions les bonnes feuilles de ses livres, parus aux Editions Guérin. Le premier, 8000+, est un récit d’apprentissage fait d’exploits, de persévérance, mais aussi de tragédie.
À ce moment du récit, Ueli Steck revient sur sa carrière. Le 17 avril 2011, il vient de réussir le Shishapangma en un temps record de 10h30, par la face sud. Dix-huit jours plus tard, le 5 mai, il parvient au sommet du Cho Oyu, 8201 m.
Pas si simple de résister à la pression. Dès qu’on dépend d’un
sponsor, il faut communiquer, raconter une histoire qui puisse
intéresser. De nombreuses sociétés scénarisent ainsi les voyages
et expéditions de façon à optimiser la photographie et le film,
car l’image est essentielle pour construire une notoriété. Mais si
un athlète recherche une performance de haut niveau, il est rare
qu’il puisse s’encombrer d’une équipe de tournage ; ce qui rend
l’histoire sans valeur d’un point de vue marketing. Sans compter,
bien sûr, la possibilité d’un échec à cause de la météo ou de mauvaises
conditions. Pour ma part, je souhaite rester fidèle à mon
objectif : repousser mes limites, même si cela ne va pas dans le
sens des sponsors.
Ma percée dans les médias n’avait sportivement rien eu de très
spectaculaire. J’avais escaladé, dans les Tours des Wendenstock,
une voie de sixième degré en solo, sans corde pour m’assurer. J’y suis retourné
plus tard avec le photographe Röbi Bösch, qui a pris des photos
impressionnantes qui m’ont permis d’être connu. J’avais déjà
escaladé des voies dans le 8, sans corde, mais à part moi, cela
n’intéressait personne. Ce qui compte n’est pas tant de réaliser
la plus belle performance, mais de ramener le plus beau film ou
les plus belles photos ; une réalité qui peut effectivement mettre
la pression à d’excellents athlètes.
J’aime l’alpinisme et être dehors mais je donne parfois beaucoup
trop de valeur à mes actes. Il faut que j’accepte l’idée que ce que
je fais n’a guère d’importance, comme me l’a expliqué le psychologue
du sport Jörg Wetzel. Ainsi, pourquoi attendre le beau temps
dans ce camp, alors que j’aurais pu rentrer immédiatement à la
maison ? C’était pourtant une bonne base pour préparer l’Everest,
notre véritable objectif après le Shisha. La phase d’acclimatation
étant dernière nous, nous pouvions à présent vraiment faire de
l’alpinisme. Cette idée a maintenu ma motivation intacte. Si cela
ne marchait pas, ce ne serait pas si tragique.
En 2005, Ueli Steck continue de faire ses armes en Himalaya. Il se lance dans la première ascension de la face nord du Cholaste (6440 m) en solo, au Népal. Le Cholatse représente le climax de son expédition baptisée « Khumbu express ». Avec le recul, Ueli qualifiera cette ascension en solo de « téméraire, atteignant la limite à ne pas dépasser ».
D’après mon altimètre, j’avais gravi environ huit cents mètres ;
impossible de redescendre par là avec mon équipement. Avec
soixante mètres de corde, il m’aurait fallu poser trente rappels,
ce qui demandait une quantité de pitons, sangles et broches que
je n’avais pas. J’avais déjà dépassé le point de non-retour.
Je regardai ce qu’il me restait à parcourir : sept cents mètres
qui se redressaient vers le sommet. Je m’offris une petite pause,
avalai une barre énergétique et bus un peu de thé. Puis, je repris
ma progression. Peu à peu, mes mollets commencèrent à tétaniser.
La position debout sur les pointes avant était épuisante à la longue.
Je dus bientôt m’arrêter, parce que la lame de mon piolet
s’était desserrée. J’avais mis la clé Allen dans la poche supérieure
de mon sac à dos. Je la sortis avec beaucoup de précaution, en
m’interdisant de la laisser tomber. C’est pourtant ce qui se passa :
elle glissa entre mes doigts et m’échappa. Sidéré, je la regardai
disparaître dans le vide. Je n’arrivai pas à y croire ! Je tentai, avec
mes doigts, de visser le boulon autant que possible ; une tête de
piolet branlante est la dernière chose dont j’avais besoin. Dès lors,
je contrôlais très régulièrement le serrage de l’écrou. Si le boulon
lâchait, c’était la chute. Au mieux, seule la lame pouvait tomber et
je resterai pendu à la paroi, sur un seul piolet, dans une situation
désespérée. Rejetant ces pensés morbides, j’essayai de m’arranger
de mon handicap.
Je dérivai un peu vers la gauche en direction d’un large couloir
de glace qui menait à l’arête sommitale. La lumière du jour déclinait.
Je n’avais pas remarqué à quelle vitesse le temps avait défilé,
tellement j’avais été pris par mon incident, la progression et les
prises de mains et de pieds. Je réalisai à présent combien j’étais
sous pression. Un bivouac était inévitable, il m’était impossible
d’atteindre le sommet avant la nuit. Ne trouvant aucun replat
à proximité, je continuai pour essayer de trouver au moins un
endroit où m’asseoir. Dans l’obscurité grandissante, je grimpai
encore deux cents mètres à l’aide de ma lampe frontale. Peu à
peu, la nervosité m’envahissait. J’étais à 6 000 mètres et n’avais
encore rien trouvé de convenable. Je poursuivis donc, avec un
champ de vision réduit à mon faisceau de lumière. Enfin je trouvai
une petite vire recouverte de neige soufflée. Il devait être possible
de dégager une surface plane. Je jouai du piolet pour préparer
une petite plateforme. Enfin, je pouvais m’allonger, étendre et
dégourdir mes jambes ! Je me glissai dans mon sac de couchage,
tout en gardant mon harnais afin de rester assuré. La couchette
n’était pas seulement exposée, elle était aussi inconfortable, et
pas aussi plate que je l’aurais souhaitée. Partout, je pouvais sentir
les aspérités du sol. Lorsque je commençai à faire fondre de la
neige, je réalisai combien j’étais fatigué. Mais je devais me forcer
à manger et à boire, sinon je n’aurais été bon à rien le lendemain.
Pour la première fois de la journée, je ressentis la solitude.
Loin dans la vallée, je pouvais voir les lumières des habitations. Je
savais que le seul chemin de retour passait par le sommet et par
le flanc sud. Mais pourrais-je trouver la voie ; comment serait le
terrain du lendemain ? J’espérais simplement que, d’une façon
ou d’une autre, j’arriverais à me sortir de ce guêpier. J’essayais de
me raisonner et de me donner un peu de courage en me disant :
« Tu peux le faire, il n’y a plus que quatre cents mètres jusqu’au
sommet et tu en as fait déjà mille aujourd’hui… » Je bus une
tasse de thé, puis aussitôt en préparai une autre. Toute la nuit,
mes pensées tournèrent en rond. Pourtant, le lendemain, j’étais
heureux d’être de nouveau dans l’action. Dès que je commençai
à grimper, la tension s’évacua. Seul l’instant présent comptait.
En 2008, après une première tentative en face sud de l’Annapurna, Ueli Steck et Simon Anthamatten se portent au secours de deux espagnols, qui appellent au secours sur l’arête ouest de l’Annapurna. Ils sauvent Horia mais Steck, seul, ne peut sauver Inaki Ochoa, qui décède dans ses bras à 7400 mètres. Ueli doit se battre pour rentrer entier et échapper de justesse au mauvais temps, « au bout de lui-même ».
Pendant la soirée, nous avons essayé de persuader Horia de
descendre seul. Iñaki allait de plus en plus mal et nous ne pouvions
en aucun cas descendre deux alpinistes invalides. Pendant la nuit,
Simon ne s’est pas senti bien et a vomi. Il montrait les premiers
symptômes du mam. Au petit matin, nous décidâmes qu’il valait
mieux qu’il reste dans la tente afin de réceptionner Horia. Je suis
donc parti avec une assez mauvaise visibilité, en me demandant
si Horia pourrait descendre seul. Je pouvais à peine avancer dans
cette épaisse couche de neige fraîche. J’ai creusé ainsi mon chemin
jusqu’à l’arête est, où les choses devinrent heureusement plus
faciles. J’arrivai à avoir un contact radio direct avec Horia, au
camp IV. Jusqu’ici, à cause du relief, je devais utiliser le téléphone
satellite ou passer par le camp de base. Il ne voulait absolument
pas abandonner son ami. Je le comprenais fort bien, mais j’étais
persuadé qu’il ne survivrait pas à une autre nuit à cette altitude.
Je l’ai fermement engagé à descendre. Il refusa.
Une heure plus tard, je tentai une feinte en prétextant que
j’avais besoin qu’il vienne à ma rencontre pour pouvoir monter
dans ses traces et apporter au plus vite les médicaments. Il mordit
à l’appât. J’étais convaincu qu’il n’aurait pas la force de faire demitour
et qu’il devrait descendre au camp III, où Simon pourrait
prendre soin de lui. Une heure plus tard, je suis tombé sur lui
presque par hasard, dans le brouillard qui nous enveloppait. Un
vrai coup de bol ! Même en descendant, il avait bien du mal à
avancer, il s’écroulait tous les cinq mètres et restait allongé pendant
deux minutes avant de se relever et de faire encore quelques
pas. Il était vidé et bien mal en point. Il me demanda à boire. Je
n’avais rien, mais je sortis le réchaud de mon sac et lui demandai
de faire fondre de la neige. Je montai alors rapidement sur le bord
de l’arête afin d’établir un contact radio avec le camp de base.
Lorsque je redescendis, Horia avait toujours le réchaud dans les
mains, dans la même position que vingt minutes avant. Je lui
pris le réchaud des mains et commençai à faire fondre de l’eau.
Pendant ce temps je téléphonai à Oswald Oelz, pour lui demander
combien de Dexaméthasone je devais donner à Horia. « Dans son
état, autant que tu en as », me répondit-il. Je lui en injectai une
bonne dose, en gardant le reste pour Iñaki.
Après avoir bu, Horia reconnut qu’il était trop épuisé pour
remonter. Mon plan avait fonctionné. J’ai estimé qu’il pouvait
descendre seul et ainsi me permettre de rejoindre au plus vite son
compagnon. S’il était déjà mort, je retournerai immédiatement
soutenir Horia. Je contactai donc Simon en lui demandant de venir
à sa rencontre, puis envoyai Horia en bas en lui recommandant
de m’appeler tous les quarts d’heure. Mais il était à peine lucide,
il me contacta néanmoins après quinze minutes.
Je le distinguais à peine à travers le brouillard. Il me sembla
cependant que sa démarche était un peu moins chancelante. Je
luttai moi-même pour avancer. Après quarante-cinq minutes,
Horia me contacta à la radio. Il avait l’air presque normal. Je lui
donnai des indications claires sur l’itinéraire à suivre, mais ne fus
vraiment soulagé que lorsque Simon m’appela pour me dire qu’il
venait de le rencontrer. Nous en avions sauvé au moins un, car
depuis le camp III il était facile de le redescendre.
Je suis arrivé au camp IV. La tente était presque entièrement
recouverte de neige. À l’intérieur régnait une odeur prégnante
d’urine et d’excréments. Iñaki était dans un état pitoyable. Il n’avait
pas dû sortir depuis des jours. J’ai bien cru, au début, que je ne
pourrais pas rentrer. Mais je n’avais pas le choix, car dehors le vent
soufflait avec force et Iñaki avait besoin d’aide. Il était conscient
et me reconnut. Mais il ne pouvait ni se soulever, ni bouger. La
vue de son bras droit m’épouvanta. Il était gelé et noir des doigts
jusqu’en dessous du coude ! Aussi vite que possible, je lui injectai
du Dexaméthasone et lui donnai des analgésiques. Plusieurs fois,
je répétai l’opération. Je fis aussi fondre de la neige pour le faire
boire et essayai de lui faire manger mes maigres provisions et une
barre énergétique. Je ne gardai pour moi que deux sachets de soupe.
Après un moment, il m’a semblé qu’il allait un peu mieux. Il
fallait maintenant, en attendant les autres, tout faire pour le garder
en vie. Le camp de base m’informa que des alpinistes, parmi lesquels
le spécialiste kazakh Denis Urubko, avaient pris l’avion depuis
Katmandou pour nous rejoindre. Ils emportaient des bouteilles
d’oxygène et étaient en train de monter. Il faisait nuit maintenant.
Voilà plus de douze heures que j’étais auprès d’Iñaki. J’essayai en
vain de dormir. La tente était très étroite et Iñaki devait vomir
en permanence, la plupart du temps sur moi. Mais, au moins, la
Dexaméthasone semblait faire effet car, à présent, il pouvait parler
de manière plus claire.
Après une tentative sur le pilier ouest du Makalu (8563 m), par la voie française, Ueli Steck doit se rabattre sur la voie normale tant la neige est abondante. Il atteint le sommet le 24 septembre 2009 mais son succès a un goût amer.
La trace était en pente douce sur le glacier. À mi-chemin, je
rencontrai Chirj qui me félicita puis m’offrit du Tang. Il avait
amené avec lui une pomme, connaissant mon goût immodéré
pour ce fruit. Elle était à moitié gelée, mais je la croquai quand
même. Il montait déménager le camp II pendant que je continuai
ma descente.
À l’endroit où nous avions installé notre premier campement,
je quittai le glacier pour marcher sur la moraine. J’étais enchanté
d’abandonner la neige et la glace. Après les hauteurs glacées, j’étais
heureux d’être de retour chez les hommes ! À partir d’ici, j’avais
même un vrai sentier jusqu’au camp de base. Je retirai mes crampons
et les attachai à mon sac. Un peu plus bas, je rencontrai Andi.
Nous nous sommes arrêtés longuement au soleil. J’eus bien du
mal à me relever tant ma fatigue était grande. Nous avons atteint le
camp de base vers midi. Comme dans un rêve, il me semblait être
descendu pendant une éternité. J’étais à la fois content et anéanti.
Le réveil fut brutal quand j’ai retiré mes chaussures pour tremper
mes pieds dans une bassine d’eau chaude. Mes orteils étaient
devenus violets, le signe indiscutable de gelures. Ce fut un choc.
J’avais pensé que les massages de Röbi suffiraient à dégeler mes
doigts de pieds. J’aurais dû faire demi-tour avec Röbi et sauver
mes pieds mais j’avais décidé de continuer. Je regardais mes orteils
gonflés et violets, navré et furieux contre moi.
Pour ne rien arranger, je me posais des questions sur le fait
d’avoir laissé Röbi descendre seul. Avais-je été aveuglé par mon
objectif ? À ce moment-là, Röbi semblait à peu près en forme,
mais comment pouvais-je prévoir qu’il aurait des problèmes sur le
chemin du retour ? Il n’empêche… Étais-je devenu trop égoïste ?
À presque 8 000 mètres, nous avions fait la trace à tour de rôle.
Sans Andi et Röbi, jamais je ne serais arrivé au sommet.
Cette expédition au Makalu m’a laissé un sentiment mitigé.
D’un côté, j’étais fier de mon succès, même si je n’avais pas pu
grimper le pilier ouest. D’un autre côté, je revenais avec des orteils
qui resteraient à jamais sensibles au froid. Je considérais ces gelures
comme une défaite, conséquence d’une mauvaise évaluation de
la situation. C’est ce qui arrive à ceux qui se lancent dans des
entreprises au-dessus de leurs moyens. Avec le recul, j’ai compris
que j’avais dépassé mes limites avec le Makalu. Cette expérience
me servirait de leçon.
Lire aussi

UELI STECK : ITINÉRAIRE D’UN ALPINISTE PRESSÉ
Il y a trois ans exactement, Ueli Steck tombait au Nuptse. Une chute inexpliquée, seul, juste avant de partir pour l’Everest et tenter l’enchaînement avec le Lhotse. Le Suisse incarnait un alpinisme moderne, technique, rapide, léger, souvent solitaire, toujours engagé. En 2017, il disparaît au moment où la communauté alpine et ses pairs remettent en cause certaines de ses performances. Des réalisations lumineuses jusqu’à la part d’ombre jamais élucidée, il ya tout le parcours d’un alpiniste d’exception, qu’on le veuille ou non.

Hommage à Ueli Steck - Le film
Ueli Steck est décédé au Nuptse il y a trois ans jour pour jour, le 30 avril 2017. Ce jour là, la communauté montagnarde perdait un homme d’exception et sans doute l’alpiniste le plus emblématique des années 2000.

UELI STECK : UNE AUTRE VIE, LES BONNES FEUILLES
Deuxième partie de nos bonnes feuilles consacrées aux livres de Ueli Steck, parus chez Guérin, avec Une autre vie et cet extrait du chapitre consacré à son ascension de la face Sud de l’Annapurna, en 2013. Le Suisse y livre son récit d’ascension et y évoque les critiques qui lui sont adressées, faute de preuves du sommet. Il parle aussi, de manière prémonitoire, de la traversée Everest-Lhotse-Nuptse.