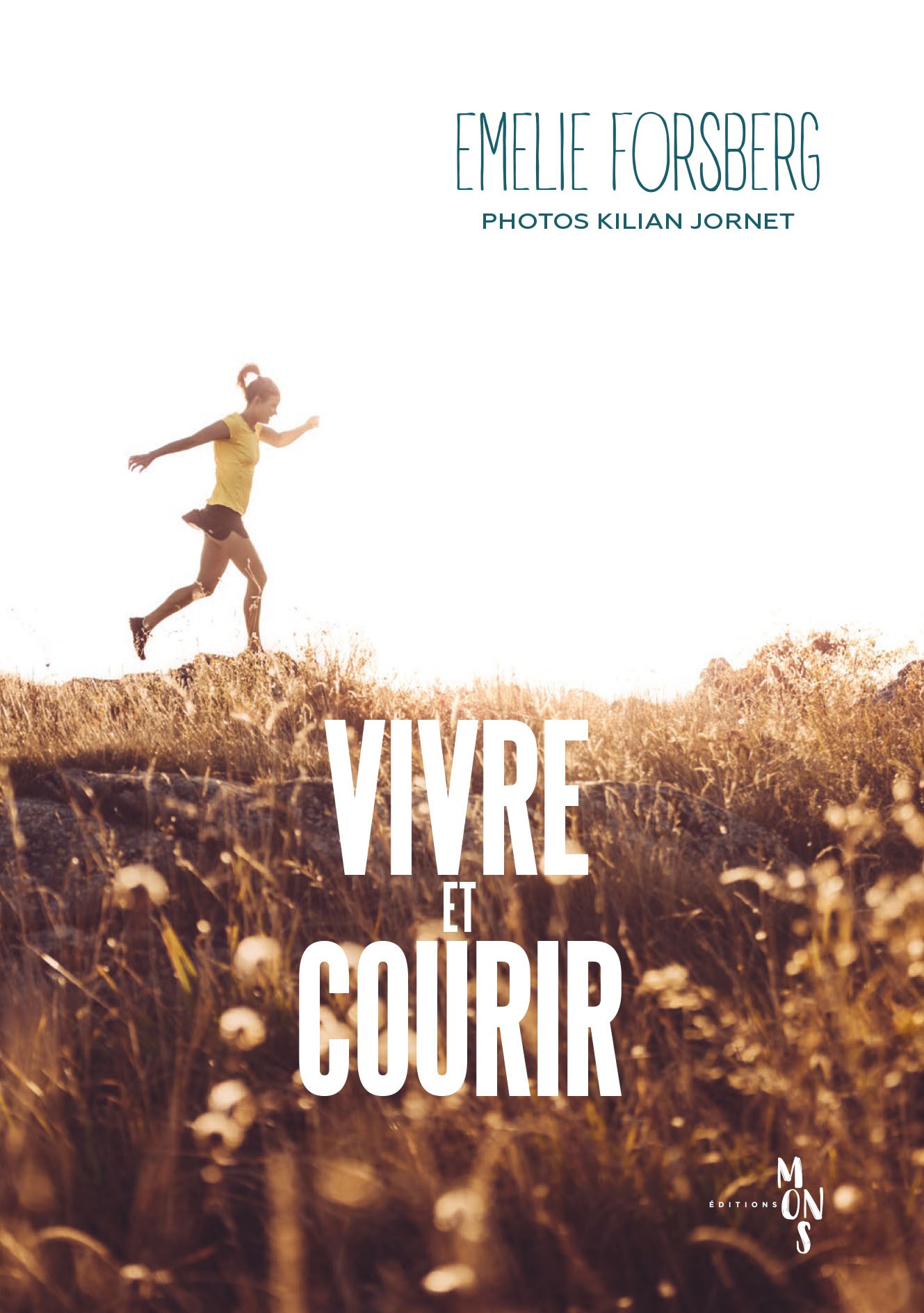Plus qu’une coureuse parmi tant d’autres, plus que la copine de…, et surtout plus encore qu’une bête d’entraînement, Emelie Forsberg a trouvé l’équilibre entre quotidien et compétition, pour courir sans oublier de vivre. Elle le raconte dans un bel ouvrage, illustré par un Kilian Jornet photographe. Des sentiers de Suède ou du Mont-Blanc, jusqu’aux pentes de l’Himalaya, le trail-running peut mener très loin.
– Extrait du chapitre 8 –
ÉTERNITÉ
Et ses possibilités infinies.
Tester ses limites et oser prendre la bonne décision.
CHO OYU, TIBET, 2017
Cho Oyu, à l’aube.
Le soleil commence à réchauffer la tente et le duvet. Bientôt, il sera l’heure de se lever et d’étendre le sac de couchage humide pour le sécher. J’ouvre la tente mais reste encore un peu au chaud dans le sac. Quelle vue !
Plus le soleil réchauffe l’atmosphère, plus il est facile de quitter la chaleur du duvet.
De nombreuses heures s’écoulent à l’intérieur de la tente lors d’une expédition – du coucher au lever du soleil. Vacances de rêve.
ENTRAÎNEMENT EN ALTITUDE
Avant de m’extraire enfin du sac, je repense aux semaines qui ont précédé l’expédition. Ces matins où j’étais réveillée par les gouttes de condensation qui me coulaient du nez et que je balayais du revers de la manche après avoir persuadé mon bras de sortir de son cocon.
Après l’avoir extrait une seconde fois, je jetai un coup d’œil à ma montre. Il était souvent 5 h 45. Une heure avant la fin de mes dix heures à endurer cette atmosphère artificiellement appauvrie. Comme il était à peine possible de se retourner, je demeurais sur le dos, attendant que le temps passe. C’était, pour Kilian et moi, notre période d’acclimatation pour le Cho Oyu, l’un des quatorze sommets au monde à plus de 8 000 mètres. Avant d’entreprendre notre marche vers le camp de base avancé, à 5 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, nous avions en effet accumulé 340 heures en machine de haute altitude, une machine qui réduit la quantité d’oxygène dans l’air, simulant ainsi l’altitude voulue. Pendant quatre semaines, nous avons dormi dans cette petite tente. De plus, nous nous étions entraînés une heure par jour avec un masque branché sur la machine, sur tapis roulant ou sur vélo d’appartement. Cela semble horrible, et ça l’était effectivement parfois. J’étais fatiguée de dormir en haute altitude. Je ne pouvais pas m’entraîner aussi dur que je l’aurais souhaité. Et qui donc veut courir sur un tapis quand le soleil brille dehors ?
LE PLAN
C’était au cours d’une sortie longue, l’automne dernier, que Kilian et moi avions commencé à évoquer l’ascension rapide des plus hauts sommets du monde. Nous venions d’apprendre qu’un couple avait gravi le Cho Oyu en deux semaines, de leur départ à leur retour chez eux. Voilà qui m’intéressait ! L’alpinisme de haute altitude me fascine depuis longtemps, mais l’idée de passer deux mois en camp de base m’avait toujours découragée jusqu’ici. Pendant nos sorties longues du côté de Skarven, chez nous dans le Romsdal, nous nous sommes amusés à imaginer une ascension encore plus rapide du Cho Oyu. Nous avons échafaudé un plan, avec ou sans les facilités du camp de base. Était-ce vraiment un raccourci que nous prenions de nous acclimater chez nous plutôt que de passer six semaines au camp de base ? Notre approche était clairement inédite et nous n’en avons parlé à personne. Si nous réussissions, parfait. Peut-être était-ce le moyen de nous habituer à la haute altitude tout en restant à la maison et en vivant nos vies quotidiennes de travail et de couple. J’aime cette idée de se fixer sur une chose pendant plusieurs semaines, comme vous le faites pour une expédition normale. C’était juste une nouvelle manière de se concentrer. Les semaines passaient et notre sommeil s’améliorait dans cette altitude simulée. À mesure que la date approchait, j’allongeais les journées d’entraînement, jusqu’à douze heures, pour préparer mon corps à la tentative d’ascension du sommet. Je m’entraînais pour gagner en confiance sur un terrain plus technique, comme la glace et les rochers, laissant de côté les séances plus courtes, rapides et intenses, car je n’arrivais simplement pas à récupérer. Dormir à haute altitude consume votre énergie.
Nous venions d’apprendre qu’un couple avait gravi le Cho Oyu en deux semaines, de leur départ à leur retour chez eux. Voilà qui m’intéressait !
CAMP DE BASE
La saison de ski prit fin et le moment vint enfin de partir. À peine quelques jours plus tard, nous étions à pied d’œuvre. C’était incroyable : nous passions des cérémonies et des célébrations de la fin de saison de ski en Italie, à l’humilité de se sentir si petits et insignifiants face aux géants de la plus haute chaîne de montagnes du monde. On nous a déposés au bout de la route, sur le haut plateau tibétain, et nous avons entamé notre marche vers le camp de base avancé. Selon nos recherches et notre carte, il se situait à environ 8 kilomètres le long d’un glacier. Au loin, nous apercevions des montagnes dont nous ignorions le nom, à la frontière du Népal. Nous avancions tranquillement et je songeais aux sensations que procure l’altitude. Presque 5 000 mètres. Comment cela allait-il se passer ? Était-il réellement possible de s’acclimater à l’aide d’une machine de simulation de haute altitude ? Certes, le niveau d’oxygène pouvait être simulé, mais la pression atmosphérique, comment allait-elle affecter notre corps ? Avions-nous été stupides de tester cette méthode ? À notre connaissance, très peu l’avaient tentée. Ceux qui s’étaient acclimatés à l’aide d’une machine similaire avaient commencé à utiliser de l’oxygène dès le camp de base, ce qui signife 4 litres d’oxygène supplémentaires par minute. Les pensées se bousculaient dans ma tête et mes yeux ne pouvaient se détacher de la majesté, de l’authenticité et du calme qui m’entouraient. Alors que notre expédition démarrait, tout semblait à la fois totalement possible et absolument hors d’atteinte. Sans ordinateur, téléphone ou Internet, notre aventure ressemblait à un carnet vierge, attendant d’être griffonné de bulles et de réflexions pétillantes. Aucune distraction. Comme de se réveiller pour contempler la journée qui commence avec une tasse de café à la main. Après deux heures de marche, enfin nous aperçûmes notre but. Le Cho Oyu nous toisait du haut de ses 8 201 mètres. Le sommet me fit me sentir toute petite. Savoir que quelque chose d’aussi grand et éternel existe rend la vie étonnamment simple en comparaison. Peut-être que rien n’a vraiment d’importance, finalement ? Ce qui ne signifie pas que les choses soient futiles mais que nos choix, même s’ils sont importants, doivent être regardés avec distance. Nous apercevons à présent les quatorze tentes du camp de base. Bientôt, nous sommes accueillis par des sourires : sept hôtes, leurs sherpas et guides, ainsi que notre chef pour les dix prochains jours. Il fait beau et chaud, et le Cho Oyu se profile au loin.
UN NOUVEAU JOUR
J’adore le sentiment de me réveiller tôt pour entamer une nouvelle journée. De ne pas savoir de quoi le jour sera fait. Ma curiosité est telle que je peine à patienter jusqu’à l’heure du lever. Notre premier jour dans la tente n’échappe pas à la règle. Je regarde ma montre avec impatience. Quand le soleil baignera-t-il notre tente ? À quelle heure traverse-t-il le camp 1, le camp 2 et le camp 3 ? Je sors finalement avec ma grande doudoune autour de la taille. Le soleil est apparu mais ne réchauffe pas encore le camp. Il est 6 h 45. Je me dirige vers la tente cantine pour me servir un thé vert. Frissonnant légèrement, je m’assois pour attendre le lever du soleil derrière le Cho Oyu. Les premiers rayons me caressent les joues. C’est beau à pleurer. Je me sens tellement chanceuse d’être ici en cet instant.
Le deuxième jour de notre expédition, nous marchons jusqu’au camp 1, à 6 400 mètres, avec tente, tapis de sol, four et nourriture pour plus tard. Nous croisons les sherpas qui ont transporté les tentes, les cordes et le stock de nourriture pour leur première expédition. Ils sont robustes. Nous les saluons avec chaleur et commençons à discuter de l’ascension vers le sommet. Les choses sont un peu différentes cette année. Seules deux petites expéditions se trouvent sur la montagne. Cela signifie plus de travail pour eux ; ils doivent tout de même poser des cordes fixes jusqu’au sommet, alors qu’ils ne sont que six. Nous redescendons car nous ne sommes montés que pour déposer notre équipement. Dans deux jours, nous dormirons là-haut. Jusqu’à présent, notre plan d’acclimatation fonctionne. Nous allons bien, sans manifester le moindre signe du mal des montagnes. Dans l’après-midi du troisième jour, nous marchons jusqu’au camp 1 pour y dormir. Nous sommes seuls. Une petite tente orange sur un plateau, face à la cascade de glace que nous avons l’intention de gravir. Le soir même, nous faisons fondre de la neige et improvisons notre repas à l’intérieur de la tente. Lorsque le soleil se couche, la température chute très brusquement. Nous espérons que le dernier bulletin météo est juste, que le lendemain sera ensoleillé et dépourvu de vent : nous voulons grimper jusqu’à 7 400 mètres.
VERS LE HAUT
Jour six. Nous démarrons sous le soleil et progressons sur le glacier. Nous avons deux grands murs de glace à gravir, qui sont plus difficiles que nous l’avions anticipé, dans la mesure où le Cho Oyu est censé être un des 8 000 les plus faciles. Après quelques petits détours, nous atteignons bientôt le plateau entre les camps 2 et 3. Il est désert. Ni alpinistes, ni cordes, ni tentes. Nous sommes seuls. Mais je suis à ma place, confiante en Kilian et en moi-même. Je dois être actrice de mes choix, prendre mes responsabilités, escalader comme si j’étais seule, sans compter sur la moindre assistance. C’est plus que jamais le moment d’être honnête. Les enjeux sont importants, comme toujours en montagne. Je suis prête. Je le sens. À la fois pour continuer et pour rebrousser chemin. Nous poussons jusqu’au camp 3. Une expédition avec oxygène et sherpas s’arrête ici en général, au troisième jour. L’ascension totale jusqu’au sommet, puis le retour, prend six jours au total. Cela fait beaucoup de temps en haute altitude et je n’arrive pas à m’imaginer respirer de l’oxygène en permanence. Être à 8 000 mètres avec la sensation d’être 2 000 mètres plus bas. Et que quelqu’un d’autre porte votre sac, vous fixe aux cordes et vous hisse. À 7 400 mètres, je décide de redescendre. C’est à peu de choses près l’altitude que nous avions prévu d’atteindre avant la vraie tentative d’ascension au sommet. Kilian continue encore un peu, juste un peu plus haut, tandis que j’entame la descente. La pente est recouverte d’une épaisse couche de neige compacte qui ne présente pas de difficulté. Je ne me sens pas en danger. Mais voilà que je glisse sur une petite plaque de neige, qui me fait perdre l’équilibre. Pas le temps de réfléchir, j’essaie d’enrayer ma chute à l’aide des piolets que je tiens à chaque main. Rien à faire. Je ne fais que gagner de la vitesse. L’un des piolets m’échappe. Je mets tout mon poids sur celui qui me reste et je finis par ralentir ma chute. Mon cœur bat violemment. Je me redresse, flageolante, et continue la descente. Imaginez ce qu’une petite plaque de neige peut causer comme danger, sur une petite pente qui semble si sûre. Je refuse de penser aux différents scénarios possibles si je n’avais pas réussi à arrêter ma glissade. Trois cent mètres d’altitude à grande vitesse peuvent mal se terminer. Faisant preuve d’une plus grande vigilance, je poursuis ma descente en attendant Kilian.
Le printemps dans l’Himalaya offre habituellement une météo stable, mais nous savons qu’une expédition de seulement dix jours est un pari. Il ne nous reste plus qu’à attendre une fenêtre météo favorable. Nous n’avons que cinq jours et espérons des conditions plus clémentes. La vie au camp de base est agréable. Nous mangeons plutôt bien dans la tente cantine qui abrite sept membres d’autres expéditions. Nous pouvons même nous étirer à l’intérieur. Les jours de repos permettent de partager nos expériences. Chacun nourrit le même rêve : atteindre le sommet.
je suis à ma place, confiante en Kilian et en moi-même. Je dois être actrice de mes choix, prendre mes responsabilités, escalader comme si j’étais seule, sans compter sur la moindre assistance.
VERS L’ÉTERNEL
Le septième jour, nous recevons trois bulletins météo différents. Ces différences sont certainement synonymes de temps instable. Le huitième jour, nous nous réveillons sous un ciel ensoleillé qui ne tarde pas à tourner en tempête de neige. Les bulletins suivants nous annoncent du beau temps dans deux jours. Nous décidons alors de tenter notre chance. Nous n’avons plus le choix ! Le neuvième jour, nous marchons vers le camp 1, excités et un peu nerveux, tous deux perdus dans nos pensées, avec pour projet de lancer notre tentative d’ascension à minuit. Vers 16 heures, après un repas lyophilisé et avoir fait fondre de la neige pour la journée à venir, le vent commence à se lever. C’est une tempête. Nous essayons de rester calmes, cherchant le repos au fond de nos sacs de couchage. Cela marche mieux que prévu. Je finis par m’endormir et ne suis réveillée que par la sonnerie du réveil. Il est 23 h 30, la tempête est toujours déchaînée. Nous pouvons à peine nous entendre. Nous réglons le réveil pour qu’il sonne une heure plus tard en espérant que le vent se sera un peu calmé. Mais ce n’est toujours pas le cas. Nous retournons la situation dans tous les sens. Il fera froid et nous devrons rester en mouvement pour avoir chaud. Nous sommes d’accord. Nous sommes tous deux déterminés à tenter l’ascension. Car demain, nous rentrons à la maison. Une fois dehors et en route, la situation ne paraît plus si terrible. Nous avons tout laissé au camp. Nous n’apportons que de l’eau et des gels dans nos poches. Pas de sac à dos et un seul piolet par personne. Nous marchons et grimpons en silence. Le vent hurle et nous gifle. J’ai froid aux pieds et aux mains, je sens à peine le piolet dans ma main, mais mon corps reste chaud. À la lumière de la frontale, nous escaladons la deuxième cascade de glace. Je me détends. L’escalade s’est bien passée, mais les difficultés ne sont pas terminées. Nous sommes désormais à 6 900 mètres d’altitude. Le vent nous torture depuis le début de la tentative. Nous n’avons pas réussi à manger puisque le froid, attisé par le vent, nous empêche de nous arrêter une seule seconde. Il est un peu effrayant de penser que nous allons devoir rester ainsi en mouvement pour ne pas geler, mais je garde confiance. Je sais que je peux toujours faire demi-tour. Je peux encore bouger mon corps, mes muscles fonctionnent, car je suis forte. Je suis entraînée. Je sais ce que c’est que de bouger. Après environ six heures d’ascension, nous découvrons une crevasse de glacier, notre premier refuge depuis que nous avons quitté le camp. Nous mangeons un gel, mais en portant la gourde à la bouche, nous réalisons que l’eau est gelée. Elle a gelé alors que nous la transportons dans des thermos contre nos corps, sous nos doudounes ! Il est bientôt 9 h et nous contemplons un lever de soleil inoubliable. Le plus haut de ma vie. Nous sommes encore dans l’ombre et le vent fait rage. J’espère voir bientôt le soleil nous raviver, et, peut-être, le vent s’assagir. Mon vœu se réalise. Nous mangeons et buvons l’eau qui fond dans nos gourdes. Nous sommes à 7 000 mètres, soit 1 000 mètres plus haut que notre dernier camp. Il nous a fallu plus de temps que la première fois, alors que nous en avions perdu à chercher notre route. C’est crucial, mais je refuse de trop songer au temps. Quatorze heures est ma limite, l’heure à laquelle je devrai entamer la descente. Ne pas y penser. C’est ici et maintenant, un pied devant l’autre. Le froid est encore mordant mais la chaleur n’est plus très loin. Nous continuons jusqu’à la fameuse bande jaune, cette ligne de marbre et d’autres roches légères de couleur jaune-marron qui se trouvait sous le niveau de la mer, il y a 300 millions d’années (!), le signe distinctif des plus hautes montagnes du monde. Les choses deviennent difficiles. Nous sommes sur une paroi technique, un mur absolument vertical. Nous imaginions un passage facile, c’est plutôt de l’escalade avancée. Évidemment, les choses peuvent être perçues différemment suivant votre mode d’ascension. Avec ou sans oxygène. Avec ou sans des cordes préalablement posées par des sherpas. Ils ont sans doute raison, c’est plus facile ainsi. Enfin au soleil, nous évoquons la nuit épouvantable que nous avons traversée. Nous n’avons pas beaucoup parlé au cours de ces heures d’obscurité, de vent et de froid. Les mots sortent enfin. Nous sommes tous les deux surpris, presque ébahis, de notre résistance à l’altitude. C’est le dixième jour de l’expédition et nous avons réussi à nous hisser au-dessus de 7 000 mètres sans problème. Désormais, chaque mètre est plus dur que le précédent. 7 700 mètres. C’est ainsi que ça se passe. Chaque pas est une bagarre. C’est fou. Être épuisée mais capable de continuer. L’oxygène impose la limite même si le cœur ne s’affole pas. Cela rappelle la course en montagne, mais c’est autre chose. La liberté, malgré notre pas lourd. La détermination. Savoir que c’est ma seule volonté qui rend tout cela possible. Juste la mienne. Pas de raccourci. Juste grimper, grimper, grimper à travers l’atmosphère visqueuse. Grimper jusqu’au ciel.
A suivre dans Vivre & courir, Emelie Forsberg (photos Kilian Jornet), éditions MONS, 178p., 29€.